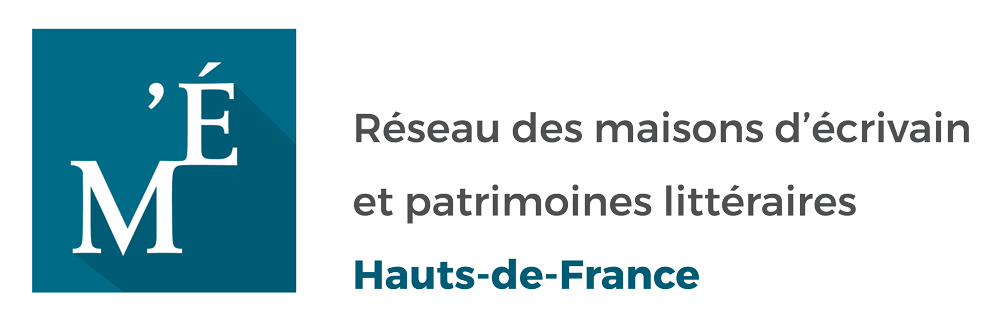Jacques Boucher de Perthes
10 septembre 1788 - 5 août 1868
Citation ?
Le 10 septembre 1788, à Rethel (Ardennes), dans une ancienne famille de la noblesse champenoise, naît Jacques Boucher de Crèvecœur, plus connu sous le patronyme qu’il se choisira plus tard, associant le nom de sa mère à celui de son père : Jacques Boucher de Perthes.
Son père, Jules Armand Guillaume Boucher de Crèvecœur (1757-1844), alors Contrôleur général des fermes du Roi, est nommé, en 1791, Inspecteur principal des Douanes à Saint-Valery-sur-Somme, puis Directeur des Douanes à Abbeville (Somme). En 1803, il installe sa famille dans l’Hôtel de Chepy, rue des Minimes, à Abbeville. C’est là que Jacques vivra la plus grande partie de son enfance et de son adolescence.
Carrière douanière
En 1802, Jacques Boucher de Perthes a quatorze ans, lorsqu’il entre aux Douanes. Les différents postes qu’il gravira rapidement le mèneront aux quatre coins de France, en Italie où il parfait son éducation intellectuelle et en Europe où lui sont confiées des missions importantes. « Les avancements ne sont pas difficiles à obtenir quand on est disposé à aller partout, vu qu’il y a une foule de gens qui sont prêts à n’aller nulle part… », écrira-t-il.
En Italie, il fréquente les salons, les fêtes, les bals princiers et côtoie les personnalités. Jeune homme séduisant, excellent danseur, il devient le valseur attitré de la grande-duchesse Élisa Bonaparte. C’est probablement à cette époque que date sa liaison avec la Princesse Borghèse, Pauline Bonaparte, la sœur de l’Empereur.
Désireux de combler les lacunes de sa culture, il entreprend l’étude de la grammaire, de la versification, étudie les classiques, prend des leçons de violon – il rencontre Paganini.
La chute de Napoléon amène sa disgrâce. Il est envoyé à La Ciotat, puis à Morlaix où il reste neuf ans.
En 1825, après vingt ans d’absence, il reprend la place de son père à la Direction des Douanes d’Abbeville.
Auteur prolixe
Hormis les ouvrages décisifs que sont pour la préhistoire les Antiquités celtiques et antédiluviennes (1849-1864, 3 vol.) et les deux plaquettes intitulées De l’homme antédiluvien et ses œuvres (1860) et La Mâchoire de Moulin-Quignon (1864), Boucher de Perthes s’est essayé à tous les genres.
Auteur de pièces de théâtre, romans, poèmes et chansons, nouvelles, récits de voyage, pamphlets politiques et méditations philosophiques, romans épistolaires et discours de morale, il ne publiera pas moins de quarante-neuf livres en soixante-neuf volumes entre 1811 et 1868, soit près de trente-mille pages.
Son œuvre littéraire fait preuve d’un style élégant et musical, les traits d’esprit et l’humour acide ajoutant encore au charme de ses écrits.
Il utilise ses dernières années pour écrire ses souvenirs dans un ouvrage en huit volumes intitulé Sous dix rois, formé d’une suite de ses lettres – réelles ou fictives – depuis 1805 à 1867.
Justice sociale
On oublie souvent que Boucher de Perthes, observateur vigoureux de la société de son temps, s’aventure aussi sur le terrain de l’économie et de la sociologie avec acuité et détermination.
Il voit se développer l’industrie, l’essor du capitalisme et la puissance de la bourgeoisie. Profondément choqué par la condition ouvrière au début de l’ère machiniste, il en analyse les travers, dénonçant l’injustice, la misère, l’inégalité des sexes devant l’éducation, le travail, le salaire. Il aurait pu s’en tenir aux constats, mais son esprit généreux l’incite à chercher des remèdes, à exposer ses plans d’organisation sociale et économique.
Président de la Société royale d’Émulation d’Abbeville
Il relance également l’activité de la Société d’Émulation d’Abbeville, que son père, avait contribué à fonder en 1797. En 1830, il en devient le Président et sera réélu tous les ans, pendant 36 ans. Il y fait de nombreux discours qui reflètent tous son intérêt pour la condition ouvrière, la morale ou son désir de faire accepter ses conclusions concernant l’Homme « antédiluvien ».
Candidat à la députation
Il s’est longtemps refusé à entreprendre une carrière politique. Il s’y résout pourtant en 1848 et se présente aux élections législatives. Le 10 mars, il publie un long manifeste où il expose son programme, souhaitant, entre autres, l’amélioration des classes populaires : « travail partout, pauvreté nulle part » ; l’allègement des impôts : « que le peuple paie au moindre prix possible le pain, la viande, le chauffage » ; l’abolition de la peine de mort : « L’échafaud n’a jamais moralisé une nation » ; la création d’une caisse de vétérance ouvrière pour « assurer le sort des vieux travailleurs ».
Moqué, traîné dans la boue à gauche comme à droite, il échoue. Il fallait quatorze représentants, il occupe le seizième rang. « Triste besogne d’être candidat ! C’est une lutte perpétuelle, un combat corps à corps contre les commères, les envieux et les sots. » écrira-t-il.
Préhistorien
Il combat trois décennies durant pour la reconnaissance de ce qu’il dénomme l’« homme antédiluvien », contemporain des grands animaux éteints. S’appuyant sur des arguments géologiques, paléontologiques et archéologiques, il parvient à réfuter l’idée d’une apparition récente de l’humanité, imposée par la chronologie biblique et par les sciences de son temps. Avec lui, l’existence humaine se creuse désormais de toute la profondeur des temps préhistoriques.
En 1849, il publie le premier volume des Antiquités celtiques et antédiluviennes, reconnu aujourd’hui comme l’un des textes fondateurs de la Préhistoire. D’abord en butte au scepticisme de l’Académie des Sciences, ses théories vont recevoir, à partir de 1857 le soutien croissant de scientifiques d’importance, comme Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, un des pères de l’évolutionnisme, Édouard Lartet, pionnier de la paléontologie, puis par le paléontologue Hugh Falconer qui encourage ses amis anglais à venir examiner les découvertes de Boucher de Perthes.
Grand voyageur
Il parcourt toute l’Europe de l’âge de 65 ans à 72 ans et fait des excursions en Afrique du Nord et en Asie. L’homme est d’une vitalité et d’une santé remarquables ; il attribue cet état de fait à ses bains froids quotidiens, dans la Somme ou partout où il peut lors de ses déplacements.
Il publie le récit de ses voyages dans sept volumes. Partisan convaincu du progrès technique et industriel, il s’enthousiasme au spectacle du développement de l’Angleterre. Esprit curieux, il décrit avec piquant et pertinence les tribus arabes d’Algérie ou les groupes Mongols de Russie, démontrant son intérêt pour l’ethnologie. On lit également dans ces pérégrinations les préoccupations du naturaliste échangeant avec ses collègues étrangers.
Généreux donateur
En 1862, il participe à la fondation du Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye par donation d’objets trouvés lors de ses recherches. Il fait également don d’une parties de ses trouvailles au Museum d’histoire naturelle de Paris.
Il lègue son hôtel particulier et ses collections à la Ville d’Abbeville ; l’hôtel de Chepy devient ainsi en 1872 le musée Boucher-de-Perthes. Il avait souhaité que les choses « restent pendant 100 ans dans le même état qu’au jour de son décès ». Les bombardement du 20 mai 1940 mettront définitivement fin à ce souhait, réduisant en miettes l’édifice et les trésors qu’il renfermait.
Outre les legs, il souhaite faire don de sa fortune à diverses œuvres charitables. Il consacre plus de 250.000 francs en divers prix d’encouragement. Il lègue ainsi, par testament, une somme de 200.000 francs à 20 villes de France, afin que tous les ans, une prime de 500 francs soit offerte à une ouvrière distinguée pour son travail et sa tenue. Le « Prix Boucher de Perthes » a perduré dans certaines de ces villes jusqu’en 1980.
Il s’éteint le 2 août 1868 à Abbeville, à l’âge de 80 ans. Il est enterré, selon son vœu, au cimetière Notre-Dame de la Chapelle.